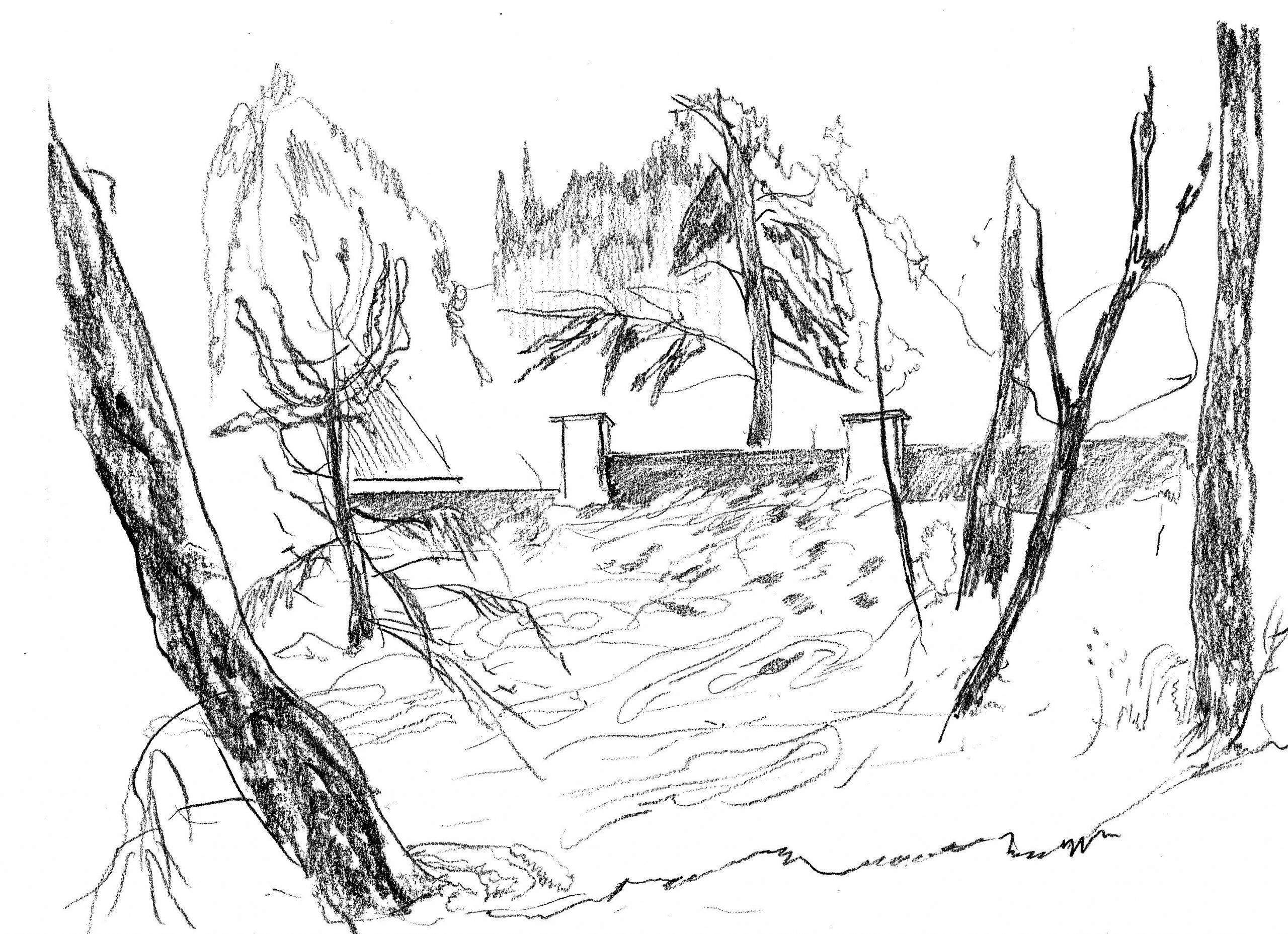- Dkript-HEBDO c'est tous les jeudis en direct
- Les podcasts de Kairos sont disponibles sur Spotify!
- Kairos 24, vous permet de voir ou revoir nos anciennes émissions
- Pour réaliser articles, reportages, interviews, vidéos…, la presse libre a besoin de votre soutien. Soutenez la presse libre, indépendante et sans publicité
- Kairos a besoin de vous pour continuer d'exister: aidez-nous à payer les frais de justice inhérent à une presse libre! ABONNEZ-VOUS!
























Sommaire
Kairos 44
Avril 2020
LE COVID-19 ET SON (IM)MONDE
Si la situation actuelle devait nous enseigner une vérité, c’est sans doute celle que c’est à la mesure d’une modification obligée de nos « habitudes » que nous pouvons prendre le temps de nous arrêter et de penser. Mais a‑t-on vraiment modifié toutes nos habitudes, sachant que celle qui consiste à s’informer, par le biais des mêmes médias qu’avant, a crû davantage ? Il est donc également probable que des chocs comme celui que nous vivons, puissent avoir l’effet inverse.
Le coronavirus n’est-il pas une forme d’apothéose de tout ce qu’il se passe depuis longtemps, qui s’inscrit cyniquement et « normalement » dans les productions d’une société qui a fait primer l’hybris (la démesure) sur le bien commun. Selon d’où l’on se situe, on pourra donc dire que rien ne va dans notre société, mais d’un autre point de vue, que tout fonctionne très bien. Dans le premier cas, on nommera les écarts indécents entre riches et pauvres qui se creusent irrémédiablement, les catastrophes naturelles qui augmentent de par leur nombre et leur ampleur, la disparition de la flore, la dramatique sujétion de la vie humaine aux algorithmes et aux écrans, la sixième crise d’extinction des espèces, etc. Dans le second, on constatera que les multinationales n’ont jamais été aussi puissantes, les médias concentrés aux mains des élites financières et autres grosses fortunes, que les dividendes pleuvent sur des riches de plus en plus riches, que la destruction est créative de richesses, concentrées, avant tout. Et que malgré tout cela, nombreux croient encore en la théorie du ruissellement.
De cette situation, ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change tireront profit. La réussite de leurs affaires dépendra de la réaction de la classe moyenne prise en étau entre les « premiers de cordée » et ce qu’il reste des classes populaires. Quel en sera l’épilogue, nous n’en savons rien. Mais l’apathie générale et l’ambivalence d’une petite bourgeoisie qui se contente de ce qu’on lui propose, troquant toute velléité de révolte contre un city-trip ou le dernier gadget made-inFoxconn, ne présage rien de bon. Pessimiste vous direz ? Il est trop tard pour penser en ces termes, établissant seulement que tout n’a mené à rien ; que les exigences étaient trop pauvres ; que l’espoir était trop présent et opportun. À l’heure qu’il est, on fait fi de l’espoir, prétexte à ne rien faire. On agit.
Il est dont utile ici de procéder à une forme de synthèse, qui fera grincer les thuriféraires de « l’appel aux gouvernants », qui ne gouvernent plus rien du bien commun depuis des décennies, mais se contentent juste d’assurer leur plan de carrière, et donc de façon subséquente et logique, de garantir la pérennité du capitalisme, dont la fin n’est qu’une accumulation, qui ne peut prendre fin, si nous y participons, que sur la dévastation de la Terre qui nous accueille.
Les propos raviront toutefois ceux qui luttent bien seuls depuis longtemps pour faire entendre autre chose que les psaumes de l’église de la croissance, relayés par leurs diocèses médiatiques. Ces derniers ont tous les âges, mais la tendance à considérer les pensées hétérodoxes comme désuètes leur accole fréquemment l’épithète de « vieux ». Certes, il peut y avoir quelque chose de valorisant à se voir qualifier de la sorte par des fidèles qui assurent la fin de l’humanité par leurs certitudes quotidiennes.
Il faudra donc débuter par la fin qui éclaire le commencement : si Coronavirus il y a et si réactions médiatisées de ce type se font jour, elles ne sont que l’aboutissement de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, et de où nous en sommes. Rien de plus, et c’est même assez simple en fin de compte. Les élites occidentales ont toujours pu compter sur une classe moyenne qui ne voulait en rien perdre de ses prérogatives. Celle-ci a donc toujours fulminé de manière affectée, laissant l’illusion de la confrontation tout en assurant en off sa propre perpétuation. Les syndicats, l’aide au développement, les ONG et associations diverses, les Parlements, ne sont que les reliquats d’une lutte qui a perdu de sa radicalité, devenus même iindispensables tant ils servaient de faire-valoir au système dominant. Il fallait feindre l’opposition, en ne s’opposant toutefois plus aucunement aux fondements du système qui leur permettait même d’exister. Les autres, révoltés, avaient prouvé, dans les zones qui constituaient nos réservoirs de matières premières et de mains‑d’œuvre, que la réelle opposition n’avait qu’une seule issue : létale. Biko, Allende, Sankara, Lumumba…, en sont le témoignage. Pendant ce temps, la généralisation du vote illusionnait le peuple qu’il participait du collectif, surtout dupe de ce tour de prestidigitation qui avait fait accepter cet oxymore d’une « démocratie participative », parce qu’il pouvait désormais jouir des fruits de la consommation marchande.
Soit, les révolutions abouties n’ont toujours été que bourgeoises. Pourquoi en changerait-il ? Nous débuterons par là, en commençant par un préliminaire toutefois, qui tentera de montrer que quelle qu’ait été la volonté d’aboutir à la crise coronovarienne présente, l’intention importe au fond peu, et c’est peut-être cela le pire : l’orgiaque est ce qui nous organise depuis longtemps, peu importe qu’il soit voulu ou non, il fait partie intrinsèque d’un mode d’organisation sociale, il en est donc sa création, toujours sa forme aboutie. L’occasion fait le larron, et tout choc fait stratégie. Le seul problème présent est que la conflagration touche ceux qui, habituellement, sont à l’abri. Avant, hier, il ne nous gênait pas trop de consommer les objets et les vêtements montés et cousus par des esclaves asiatiques, ou d’envoyer nos restes électroniques en Afrique. On le savait, l’important n’était et n’est toujours pas l’information, mais la volonté d’être libre, qui implique celle de penser. Elle se meurt, et la génération « smartphone » en signe peut-être la fin.
La suite sera une tentative d’explication non-exhaustive de ce fait pérenne que, toujours et encore, rien ne change vraiment, donc que tout s’aggrave, et que se perpétue sans fin, et c’est là sa pure logique, le « changement dans la continuité ». Nous nous arrêterons sur cette pratique à l’innocuité estampillée pour l’ordre en place, que sont ces applaudissements quotidiens pour le corps médical. Cela nous offrira une transition idéale, nous permettant de questionner la médecine bureaucratique que ne peut interroger un simple claquement de mains, fourre-tout bruyant bien sympathique « positif » dans la novlangue. Donc inoffensif.
Il faudra terminer en rappelant que le neuf n’a rien de nouveau et que l’inédit ne se pare de ces habits que pour nous faire oublier qui nous sommes et pourquoi nous y sommes. Aujourd’hui, « nous sommes tous Covid-19 ». Saurons-nous en tirer les conclusions, ou, comme le disait le lucide Jaime Semprun, s’évertuer encore et toujours à « ne pas conclure » ?