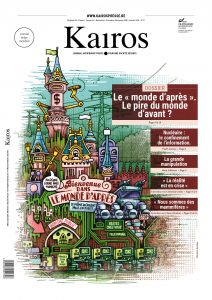Les philosophes actuels qui pensent la multi-dimensionnalité du réel, abordent les questions morales sans faux-fuyants et sans craindre la répression bien-pensante ne sont pas (assez) nombreux. Christian Godin, professeur émérite de l’Université de Clermont-Auvergne né en 1949, est l’un d’eux. Après avoir exploré les thèmes de l’utopie (2000), de La fin de l’humanité (2003), du Triomphe de la volonté (2007), de La haine de la nature (2012), de La démoralisation (2015), des péchés capitaux et des Lieux communs d’aujourd’hui (2018), dans son nouvel essai, paru aux éditions Champ Vallon, il s’attaque à La crise de la réalité. Formes et mécanismes d’une destitution.
Bernard Legros l’a interviewé par voie électronique. Réalité ou virtualité ?
Depuis quelque temps paraissent des essais (de Myriam Revault d’Allonnes, Fabrice Flipo, Jean-Marc Ferry, Kevin Cappelli, Bertrand Vergely) tentant d’expliquer ces phénomènes inquiétants en plein essor des fake news, de la « post-vérité » et des « faits alternatifs ». Si la propagande et la désinformation existent depuis longtemps, ainsi que les simulacres et les processus de déréalisation pointés par Jean Baudrillard à la fin des années 1960, quelle est la spécificité de ces manifestations nouvelles ? Est-ce inédit dans l’histoire de la civilisation ?
Certes, la propagande est aussi ancienne que les États et la rumeur aussi vieille que la frayeur populaire, mais il y a en ce domaine deux différences essentielles, d’ailleurs corrélées, entre aujourd’hui et hier. Lorsque le Pharaon faisait graver sur les pierres le récit victorieux d’une bataille qu’il avait en réalité perdue, il ne disposait pas du formidable appareillage technique qui est le nôtre et son mensonge ne trompait qu’un nombre limité d’individus. Les deux différences essentielles entre l’idéologie d’aujourd’hui et celle de jadis tiennent à la puissance de la technique qui leur sert de support (l’écriture d’un côté, le numérique de l’autre) et à l’extension de leur pouvoir (local autrefois, mondial aujourd’hui).
Kairos : Quelle différence faites-vous entre la vérité et la réalité ?
Entre la réalité et le réel ?
Christian Godin : Il n’y a de vérité qu’à partir de et qu’au moyen de la fonction symbolique. La vérité est une valeur logique dépendante du langage, à condition que celui-ci soit suffisamment complexe pour comprendre la fonction de négation (la danse des abeilles ne peut ni tromper ni dissimuler). Un énoncé est vrai si ses conclusions sont conformes à ses prémisses (vérité logique), ou s’il est conforme à la réalité (vérité physique). La réalité peut être définie comme ce qui existe en dehors de la représentation, donc du langage même si, bien entendu, elle ne peut être appréhendée que par lui. Aucun philosophe dit « idéaliste » d’autrefois n’a jamais contesté la réalité de Dieu ni celle de sa propre pensée. Même un phénoménisme aussi radical que le bouddhisme ne peut éviter de se représenter l’illusion universelle et le nirvana comme des réalités. Les adjectifs substantivés comme le beau ou le réel ont une extension plus large que les substantifs (la beauté, la réalité). Par exemple, la conception romantique du beau est plus large que la conception classique de la beauté car elle englobe l’étrange, et même le laid ou le monstrueux. À la limite le réel se confond avec l’être, puisque la réalité immédiate, empirique, se voit réduite au rang de particularité. Il y a pourtant un autre du réel, son négatif, l’irréel. Mais comment éviter de penser la réalité de l’irréel auquel cas c’est la réalité qui englobe le réel ? On ne peut esquiver ce genre de tourniquet.
La fuite du réel s’observe aussi dans le subjectivisme débridé de nos contemporains. Le solipsisme a‑t-il de beaux jours devant lui ? Vous allez jusqu’à parler d’« attentats contre le réel nombreux et violents »…
Effectivement, parmi les facteurs d’effacement du réel (lequel comprend plusieurs modalités : l’oubli, l’indifférence, la haine, le refoulement, la destruction…) le subjectivisme est l’un des principaux, car il va de pair avec un relativisme incompatible avec l’idée élémentaire d’objectivité. Mais il faudrait faire la distinction entre le subjectivisme et l’individualisme car il semble que désormais l’individu travaille contre le sujet ce qui, il y a quelques décennies, eût paru incompréhensible. On le voit avec le narcissisme, lequel apparaît d’abord comme une exacerbation de l’individualité, mais qui peut dans un second temps être analysé en termes de destruction du sujet, donc de l’individualité qui en est une dimension. Plus le sujet est vide, c’est-à-dire dissocié du réel, et plus il ressentira le besoin de fournir de lui des simulacres qui en tiendront lieu. Les selfies sont ces simulacres.
À l’inverse, la technoscience ne s’impose-telle pas comme une hyper-réalité à tendance totalitaire ?
La dimension totalitaire de la technoscience contemporaine avait déjà été soupçonnée par des philosophes comme Günther Anders, Hannah Arendt et Hans Jonas, fortement influencés sur ce point par Heidegger. Les deux caractères essentiels du totalitarisme, le contrôle absolu des existences et la violence destructrice s’y retrouvent. La technoscience substitue son monde à celui de la nature — même l’écologie admet ce remplacement comme une fatalité puisqu’elle parle d’environnement bien davantage que de nature. S’agit-il d’une hyper-réalité ? Je n’en suis pas sûr. « Hyper » signifie le dépassement et l’augmentation. La prétendue réalité augmentée est en réalité (c’est le cas de le dire !) une réalité diminuée.
Les représentations ne se sont-elles pas aujourd’hui presque complètement détachées de la réalité, alors même qu’elles ne constituent « pas une base épistémologique fiable pour conclure à la réalité » (Jean-Marc Ferry, 2019) ? Le cas échéant, assisterions-nous à une sorte de double détachement ? Avec quelles conséquences ?
Certes, on peut faire cette analyse, bien des exemples, bien des faits la confirmeront. Mais il ne faut pas oublier que le monde des représentations est loin d’être homogène. Peut-être d’ailleurs n’at-il pas été dans le passé humain aussi hétérogène qu’aujourd’hui. Songeons que dans toutes les disciplines, nous sommes en train de vivre l’âge d’or de la science, c’est-à-dire de la connaissance objective. Prenez l’archéologie, la géologie, la climatologie : elles nous donnent de notre monde présent et passé une représentation de plus en plus fidèle et précise, telle qu’il n’y en eut jamais d’équivalent dans tout le passé de l’histoire humaine.
Dans votre nouvel essai, vous distinguez plusieurs formes et mécanismes de la destitution de la réalité. Certains sont déjà connus des amateurs de philosophie — le présentisme, le négationnisme, le complotisme, le nihilisme —, d’autres moins l’artificialisme, le simulationnisme, le prédictionnisme et le fictionnisme. Pouvez-vous définir ces derniers ?
Ces termes, qui ne sont pas des néologismes, se définissent aisément par leur radical. L’artifice, la simulation, la prédiction et la fiction ont ceci de commun de se substituer à la présence immédiate de la réalité naturelle, de la réalité objective et de la réalité présente. La désinence ‑isme renvoie à un travail de systématisation. Par exemple, nos moyens d’information consacrent désormais plus de temps à nous parler de ce qui peut arriver (ce « peut » étant déclinable en une multitude de modalités, de l’hypothèse arbitraire à la probabilité calculable) au lieu de ce qui est arrivé. Le terme de « spéculation » est un signe de cette métamorphose : il ne s’agit plus de penser la réalité telle qu’elle est mais de l’envisager telle qu’elle peut être. Pareillement, les outils de la physique et de la biologie nous servent aujourd’hui moins à la connaissance du réel qu’à sa manipulation.
Sur un plan anthropologique, comment voyez-vous le déploiement attendu de la réalité virtuelle dans toutes les strates sociales ? Quel rôle joue le numérique dans la destitution de la réalité ? Sera-t-il encore possible d’enseigner, de transmettre, de faire société ?
Le gros problème, le gros défi, c’est que la réalité virtuelle ne peut faire un monde commun. « Un seul lit pour deux rêves » énonce un dicton chinois. Je ne peux rencontrer autrui, faire société avec lui que dans le monde physique. Il est clair que le numérique tend à destituer ce monde pour lui substituer le sien. Je crois que nous sommes en train d’assister à la disparition des sociétés globales au profit des communautés particulières. Mais il est possible aussi que dans le même temps une société mondiale soit en train d’apparaître. N’oublions pas que le propre d’une société, à la différence d’une communauté, c’est que les gens qui en font partie ne se connaissent pas et que leurs intérêts sont divergents.
Notre monde paraît à la fois désymbolisé sur le plan social — par la perte des valeurs traditionnelles et l’emprise technologique
— et sur-symbolisé sur le plan cognitif — par l’hégémonie des signes sur les choses. Comment expliquez-vous cette contradiction ?
Je pense que cette contradiction est plus apparente que réelle, et que nous n’utilisons pas la notion de symbolique dans le même sens dans les deux cas. L’hégémonie des signes sur les choses peut très bien correspondre à une désymbolisation des représentations. Qu’on compare une lettre manuscrite, telle qu’on s’en écrivait par millions jadis, et un mail. La pauvreté du langage de ce dernier est frappante. On parle beaucoup de l’effondrement de la biodiversité, mais l’effondrement de la diversité linguistique est aussi radical. On prévoit que d’ici la fin de ce siècle les neuf dixièmes des langues parlées dans le monde auront disparu. Parallèlement à ce processus, les langues subsistantes se seront considérablement simplifiées, par conséquent appauvries.
Vivons-nous dans une civilisation de l’image ? Je me rappelle cette expérience philosophique que je fis à l’été 1987 : debout devant le Grand Canyon du Colorado, je fus déçu, je le trouvais moins beau que les photos que j’en avais vues auparavant ! Vous parlez de « l’incapacité des spectateurs abreuvés d’images à boire le réel à sa source »…
Effectivement, nous sommes tellement pris par les images que la réalité nous déçoit. Le phénomène de la précession des images sur la réalité, qui inverse la relation immédiate et logique (qui a contribué, depuis Platon, à dévaloriser les images comme simulacres) a été bien analysé par Baudrillard. Il ne peut avoir sur notre rapport au réel qu’un effet déstabilisant. L’émerveillement est le sentiment que nous voyons les choses pour la première fois or, avec les images, le réel arrive en second. L’admiration est le sentiment que les choses sont plus grandes que nous et qu’elles n’ont pas besoin de nous pour exister, or, avec les images, le réel se retrouve dans un état de dépendance, il nous paraît n’être pas à la hauteur. À la différence du voyage, le tourisme est précédé par les images, et ce sont elles qui le constituent, d’où cette impression d’effacement du monde. On pourrait aussi donner l’exemple du sexe, désormais précédé, accompagné et constitué par la pornographie.
Nos sociétés développées n’ont-elles pas un besoin urgent de stabilité, plutôt que de changement permanent ? Ne devraient-elles pas se ressourcer dans ce que le passé a de meilleur pour construire l’avenir ?
Certes, mais ce vœu est de l’ordre de l’impossible. Gouvernées et structurées par la technoscience, les sociétés contemporaines sont engagées dans des processus irréversibles. C’est une grande différence entre la modernité et la tradition. La tradition n’assurait pas seulement la répétition, elle rendait possibles les retours en arrière. On n’a jamais inventé et on n’inventera jamais des machines à ralentir ni des machines moins performantes que les précédentes. Cette irréversibilité s’impose à l’échelle de l’Histoire universelle dont l’horizon est celui de l’âge atomique et de la catastrophe climatique et environnementale.

Même si certains phénomènes sont irréversibles à l’échelle civilisationnelle, comme les dérèglements climatiques, n’est-ce pas démobilisateur de parler d’irréversibilité à propos d’autres aspects de nos existences ? Cela ne signe-t-il pas la fin de la politique et le triomphe de la gestion autoritaire des catastrophes ? À propos du système technicien, deux conceptions s’affrontent, celle de Jacques Ellul, qui postulait son autonomie, et celle de Theodor Kaczinsky qui remarquait au contraire que ses produits sont des créations de l’homme imposées à une majorité d’hommes par une minorité d’autres, et donc que le système technicien relève du rapport de force politique. Si je comprends bien, vous penchez du côté d’Ellul ?
Votre première question signale indirectement le divorce peut-être irréparable entre le caractère nécessairement critique de l’analyse théorique et l’exigence moins nécessaire de l’efficacité pratique, ou bien entre ce que Gramsci appelait le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté. Mais comment ne pas voir que l’irréversibilité, qui est la logique même de l’histoire des sciences et des techniques, emporte aussi l’ensemble de l’existence humaine, tant individuelle que collective ? L’idée de retour est un beau mythe, mais c’est un mythe, que ce soit au niveau personnel (on ne repart jamais à zéro) ou au niveau général (le retour à une origine censément pure est une illusion funeste). Cela dit, si la volonté humaine ne peut supprimer la direction prise par l’Histoire, elle peut l’infléchir. Et c’est toute la différence qu’il y a entre le Destin, contre lequel on ne peut rien, et les déterminismes, qui rendent possible l’action à partir du moment où on les connaît. Cela étant, la fin de la politique entendue comme action consciente, volontaire et conflictuelle peut très bien être envisagée. Après tout, c’est ce à quoi tendent un certain libéralisme, depuis ses origines, et aussi le projet technocratique qui vise à remplacer le gouvernement des hommes par le pouvoir sur les choses. Marx disait que les hommes font l’histoire qui les fait. Dans Critique de la raison dialectique, Sartre théorise ce cercle avec son concept de « pratico-inerte » : le produit de la volonté, c’est-à-dire l’ensemble de ses effets sur la nature et sur le monde social finit par devenir une résistance qui non seulement s’oppose frontalement à la volonté, mais détourne ses objectifs. Il est vrai que les techniques nouvelles sont imposées par une minorité à une majorité, mais cette minorité est elle-même le produit de la technosphère dont les agents sont parfaitement interchangeables. Sans Bonaparte, il n’y a pas de 18 brumaire, tandis que sans Ray Kurzweil, il y aurait de toute façon eu le transhumanisme. La politique (à condition que l’on accepte le postulat selon laquelle elle est l’expression de la volonté humaine, ce qui est discutable) est la gestion de la contingence (ce que les populismes sont dans l’incapacité de comprendre). Il n’y a pratiquement aucune contingence dans la technosphère. De ce point de vue, je suis effectivement plus proche d’Ellul que de Kaczinsky, à cette nuance près, toutefois, qui est considérable, que je ne pense pas du tout que, comme le soutenait Ellul, la technique soit notre sacré, qu’elle ait pris la place du sacré. En réalité la technique est la plus formidable puissance pour la désacralisation de la totalité du réel.
Vous constatez que « nous avons tout à redouter du futur » ; mais si on regarde les techno-progressistes, leur foi en l’avenir — en leur avenir ! — est intacte. Pensons au messianisme transhumaniste, par exemple. Ressortit-il à ce que vous appelez le prédictionnisme ?
Lorsque je dis que nous avons tout à redouter du futur, je parle moins en mon nom propre que je ne me fais l’interprète d’une opinion commune, du moins en Occident. Cela dit, si notre croyance au Progrès apparaît désormais impossible au vu des multiples catastrophes du siècle écoulé, notre croyance au progrès résiste bien : nous pensons toujours que la croissance du PIB, que l’augmentation de l’espérance de vie et que nos lois sociétales sont des progrès. D’autant que le passé historique, naguère objet d’admiration et exemple pour le présent, est devenu objet de honte et n’a plus qu’une fonction de repoussoir. Pour répondre plus précisément à votre question, je pense qu’effectivement le « messianisme » transhumaniste est de type prédictionniste, car il n’est pas de l’ordre de l’espérance religieuse (raison pour laquelle le terme de « messianisme » ne lui est pas adéquat) mais de la projection technoscientifique. Le transhumanisme n’est pas une utopie, au sens banal du mot, mais un programme adossé à la fois à des savoirs et des techniques spécialisés et à un investissement économique considérable, ce qui n’était le cas d’aucune des utopies du passé.
À propos du négationnisme, est-il en lien avec le scepticisme devenu dogmatique de notre époque ? Contre Gilbert K. Chesterton — que vous citez — disant que depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ils sont prêts à croire à tout, Hannah Arendt avançait au contraire que dans une société où règnent le mensonge et la désinformation, la conséquence n’est pas que les hommes croient à n’importe quoi, mais qu’ils ne croient plus à rien…
Le scepticisme est une attitude rationnelle, et lorsqu’il est systématisé, c’est le nom d’une philosophie. C’est pourquoi on ne peut pas parler de scepticisme à propos du négationnisme. N’oublions pas en effet que celui-ci va de pair avec une hyper-crédulité aux antipodes du scepticisme. Le même individu qui met en doute des milliers de documents et de témoignages considérera comme une preuve tout ce qui sera susceptible de les contester. Cette attitude est on ne peut plus contraire à celle du doute. Le négationniste sait à l’avance ce qu’il va trouver avant de le chercher. Sa démarche est commandée par une fantasmatique inconsciente. Par ailleurs, il n’y a peut-être pas incompatibilité entre le fait de « croire à n’importe quoi » et le fait de « ne croire à rien ». On l’a vu tout récemment à l’occasion du confinement décidé pour faire face à la pandémie du Covid-19. Les mêmes personnes qui ont adhéré aux rumeurs (aussi bien négatives, concernant les causes et les responsabilités, que positives, concernant les remèdes miracles) ont parfois renoncé à penser quoi que ce soit. Mais n’oublions pas que le « ne croire à rien » est une position intenable car autocontradictoire : on ne peut ne pas croire à un énoncé qu’à partir d’une croyance inverse, de la même façon que la thèse selon laquelle la justice n’existe pas n’est possible qu’à partir d’une certaine idée de justice, laquelle contredit cette thèse.
Venons-en au complotisme, phénomène que vous prenez la peine de démonter fort justement. Cependant, d’une part ce terme n’est-il pas aujourd’hui trop facilement dégainé comme arme rhétorique pour faire taire les voix critiques et dissidentes ? D’autre part, si un Grand Complot Mondial est improbable, force est de reconnaître que l’histoire regorge de petits et moyens complots. Vous semblez ne pas donner de crédibilité aux opérations sous faux drapeau (False Flag). Par exemple, à propos de l’incendie du Reichstag en 1933, l’hypothèse d’une opération montée par les nazis est plausible et défendue par plusieurs historiens…
Personne n’ira sérieusement contester la réalité historique des complots et des conspirations (il faudrait soigneusement distinguer entre ces deux termes : la conspiration a un objectif, comme la prise de pouvoir ou l’assassinat d’un chef d’État, tandis que le complot a une finalité plus générale comme la domination ou l’élimination des ennemis). Par parenthèse, l’incendie du Reichstag par les nazis eux-mêmes est plus que plausible, c’est un fait avéré. Vous avez par ailleurs raison de dénoncer sous couvert de complotisme une instrumentalisation visant à discréditer des attitudes critiques honorables. Dans le champ politique les termes descriptifs comme fascisme ou totalitarisme sont volontiers utilisés à usage polémique, comme des insultes qui ont pour fonction de délégitimer des positions adverses. Un philosophe doit avoir suffisamment de probité intellectuelle pour s’en tenir à l’usage constatif de ces mots. Il convient de réserver le terme de complotisme à des explications globalisantes qui ont pour caractéristiques leur manichéisme et leur irrationalité. « Irrationalité » car le complotisme en dit beaucoup sur le psychisme inconscient de celui qui le défend, mais rien sur la réalité elle-même. Il est par exemple aberrant de croire, comme l’a fait l’abbé Barruel (l’ancêtre des complotistes d’aujourd’hui) que la Révolution française a été provoquée par les francs-maçons qui voulaient en finir avec le christianisme, comme il est aberrant de croire, comme le font un certain nombre d’Africains, que le virus du sida a été inventé par les Blancs pour les éliminer.
Vous écrivez (p. 283) : « Aujourd’hui, le terme nihilisme est utilisé pour désigner tantôt l’extrême lassitude d’un monde voué au relativisme universel, tantôt l’extrême violence de ceux qui préfèrent l’anéantissement (par suicide ou destruction) au néant de leur existence ». Et plus loin (p. 305) : « Bien que divergents dans leur conception de la vie humaine, les deux nihilismes, le libéral et l’islamiste, présentent, selon nous, un évident parallélisme […]. Leur racine métapsychologique commune est la pulsion de mort. Les deux visent à la destruction du monde, le premier par la techno-économie, le second par le djihad ». Y a‑t-il une recette pour sortir par le haut de cette alternative infernale, où l’affirmation de certaines valeurs d’un côté, et la négation de toute valeur autre qu’économique de l’autre, sont comme les deux faces d’une même médaille ?
Si le nihilisme, sous ses deux formes présentes, apparaît comme l’histoire destinale du monde d’aujourd’hui, il est bien entendu possible d’y échapper, que ce soit dans son existence personnelle ou dans sa vie collective. Même si la techno-économie capitaliste est totalitaire, ainsi que nous l’avons vu, il n’en reste pas moins vrai qu’elle ne gouverne pas, sans oubli ni interstice, la totalité du réel, des consciences et des vies. Tout n’est pas capitaliste dans un système capitaliste même mondialisé, ainsi que le montrent ce qui subsiste de l’État-providence, l’économie sociale et solidaire ainsi que les pratiques du don. L’immense majorité des êtres humains qui peuplent aujourd’hui la terre n’est pas nihiliste. Elle cherche à s’aménager une existence décente, sans haine ni destruction. C’est vrai du monde arabo-musulman, comme du monde occidental, du monde chinois ou du monde africain (ce sont là des commodités de langage, je ne présume aucune homogénéité dans ces « mondes »). Il n’en reste pas moins vrai que la logique de l’Histoire universelle va, me semblet-il, dans le sens du nihilisme, quand bien même personne ne voudrait la destruction générale. Personne n’a jamais voulu l’effondrement de la biodiversité, et pourtant chaque membre de l’humanité y travaille ne serait-ce qu’un peu. De même, pour prendre un exemple trivial, aucun automobiliste n’a jamais voulu l’embouteillage dans lequel il se trouve coincé, et cet embouteillage n’a jamais été décrété par aucun ministre, il n’en reste pas moins vrai qu’il y a quotidiennement des embouteillages et que chaque automobiliste y contribue pour sa part. Les pulsions de mort sont par nature inconscientes, ce sont seulement certaines de leurs expressions qui sont conscientes, et encore elles ne le sont que partiellement.
Jacques Lacan avait déjà pressenti que l’humanité de la modernité tardive se dirigerait vers une psychose collective. Êtes-vous d’accord avec cela ? Les conséquences de la pandémie de covid n’illustrent-elles pas cette prédiction ?
Lacan ne parlait pas de « psychose collective » quand il parlait de la psychose comme destin possible de l’humanité. La psychose de la « psychose collective », n’a en effet pas grand-chose à voir avec la psychose dont traitent la psychiatrie et la psychanalyse. Quand on parle de psychose collective, on s’en réfère presque toujours à un mouvement de panique générale. Or, du point de vue psychiatrique et psychanalytique, la psychose se définit par la double destruction du rapport à la réalité et de la personnalité. S’il y a eu quelque chose de psychotique, au sens technique du mot, lors de la récente crise pandémique, elle serait à chercher du côté de l’attitude de déni adoptée par certains citoyens et par certains responsables politiques, plutôt que du côté de la peur. Le confinement, qui a été l’effet immédiat de cette crise, se caractérise par deux traits contraires. D’un côté, une perte évidente du sentiment de réalité (les rues vides des villes, le développement du télétravail), mais d’un autre côté la perception renouvelée de la réalité la plus simple (le gazouillis des oiseaux, la présence des autres membres de la famille, une attention nouvelle à la nourriture…). On se gardera par conséquent de tirer des conclusions hâtives et trop générales. Cela dit, quelles que soient sa gravité et sa durée, le Covid-19 ne sera selon moi qu’un épiphénomène dans l’Histoire de l’humanité. Il y aura peut-être ralentissement ou accélération dans tel ou tel domaine, mais certainement pas une réorientation générale.
Propos recueillis par Bernard Legros