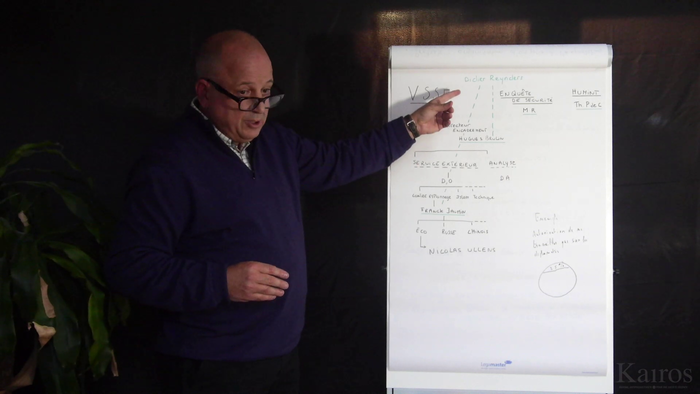Muni de sa double casquette de professeur de littérature et d’anthropologie à l’Université d’Aix-Marseille, Marc Weinstein replace la question de la sacralité politique au centre du débat, tout en actant l’évolution totalitaire de l’Occident, titre d’un de ses ouvrages (Hermann, 2015).
Entrevue liégeoise en mars 2018 avec Bernard Legros.
On glose sur la nécessité d’être cultivé pour
devenir un citoyen accompli. Vous préférez le
terme « culturé ». Pourquoi ?
Le terme cultivé renvoie à la culture savante séparée de la culture populaire. Depuis le XIXème siècle, bon nombre de « décideurs » élus ou non élus sont barbares et cultivés : pendant la journée ils jettent les salariés à la poubelle du chômage, et le soir ils vont au concert. Leur culture cultivée c’est la bonne cerise sur le gâteau avarié. À l’inverse la culture « culturée » fait société, tire l’ensemble de ses membres vers la création culturelle. À ce moment-là, la cerise et le gâteau sont frais, car c’est le peuple dans sa diversité qui crée la culture.
La dissociété néolibérale aurait ainsi le double profil paradoxal de la culture et de la déculturation ?
Tout dépend de qui on parle. Ceux qu’on appelle « les masses », qui subissent la société du spectacle, ont tendance à être incultes et déculturés, extérieurs à toute sacralité sociale et politique. En revanche, un oligarque comme Bernard Arnault est un homme barbare dans la conduite de ses affaires et un homme cultivé qui finance des musées.
Quand je travaillais dans le secteur culturel, j’avais vécu la schizophrénie habituelle : pour offrir de la culture aux citoyens, on faisait suer le burnous dans l’équipe, allant jusqu’au harcèlement s’il le fallait. La difficulté d’appréhender ce qui nous arrive dans la modernité tardive ne tiendrait-elle pas à un sentiment déroutant d’avoir affaire à des phénomènes apparemment contradictoires, comme un double mouvement d’atomisation et d’uniformisation simultanément, et à une collision entre l’objectivité et les subjectivités ?
Oui, atomisation et uniformisation sont un même mouvement vu de deux points différents. (Mais l’uniformisation n’est pas l’unification : aujourd’hui nous sommes uniformisés par la concurrence qui nous éparpille.) Dès la Renaissance, l’État et le capital atomisent les individus pour les uniformiser. Ils marchent ensemble pour créer un individu seul et faible devant eux. À la fin de l’édit de Villers-Cotterets (1539), François Ier interdit les corporations artisanales : elles doivent disparaître. L’État et le capital ne tolèrent pas la moindre autonomie collective face à eux : ils détruisent les paroisses, les corporations artisanales, la famille large, puis aujourd’hui la famille étroite. Ainsi l’individu se retrouve seul face au Léviathan. C’est encore la même logique aujourd’hui à Notre-Dame-des-Landes, où l’État refuse les projets agricoles communs et n’examine que les projets individuels.
En ce qui concerne la dialectique objectivité/subjectivités, si on adopte un point de vue anthropologique long, on constate un invariant sacré de l’homme social. Au départ du processus de sociogenèse, il n’y a pas de séparation entre le sujet et l’objet, mais plutôt une sorte de flux, comme une rivière surgissant d’un rocher : au début, il n’y a pas de rive gauche ni de rive droite ; c’est un pur jaillissement d’eau qui, plus tard, va creuser la terre jusqu’à faire apparaître deux rives, une « rive » subjective et une « rive » objective, l’une ne pouvant pas aller sans l’autre. Prenons l’image du romancier. Au moment où Balzac se met au travail, il n’est qu’un homme, et c’est l’écriture qui va faire de lui un sujet-romancier créant des « objets »-romans. L’institution de la société est ce flux permanent qui à la fois produit l’objectivité et les subjectivités. Le néolibéralisme a radicalement coupé l’une des autres. D’une part, les subjectivités contrariées sont amenées à se réfugier dans un subjectivisme narcissique ; d’autre part, une espèce d’hyper-objectivisme machinique détruit le tissu social. Ce que vous avez vécu dans le secteur culturel, c’est peut-être le fait que des contraintes dites objectives s’imposaient sans discussion (puisque « objectives » !) à votre subjectivité.
Cet objectivisme est-il celui dont parlait Ayn Rand ?
Oui, mais il provient originellement de la physique
galiléo-newtonienne et du surplomb croissant de
l’État et du capital sur la société.
La « modération extrémiste » relèverait-elle de ce qu’Alain Deneault appelle de son côté la « politique de l’extrême centre » ?
Oui. La modération extrémiste, c’est Macron, par exemple. Sous des dehors souriants, il mène une politique extrémiste en faveur du techno-capital, politique qui s’appuie sur le fanatisme de la neutralité statistique. Macron est bienveillant dans le langage et malveillant dans ses décisions. La difficulté est donc de faire comprendre que l’extrémisme se trouve aujourd’hui dans la soi-disant neutralité de la technoscience et de l’économie. Fukushima, Bure, l’aéroport de Notre-Dame des Landes sont ou étaient des projets extrémistes, tout comme la leçon entrepreneuriale que l’Occident donne à l’Afrique. De quoi nos despotes élus se mêlent-ils ?
Un numéro spécial de Kairos est intitulé « l’Occident terroriste ». Alors que cette expression semble contraire au bon sens délivré par les médias, comment la comprenez-vous ?
Je ne suis pas spécialiste du ou des terrorismes, mais une chose me semble certaine : l’Occident, qui a placé toute la vie humaine sous le signe de la Nécessité philanthropique (« on n’arrête pas le Progrès »), a placé la violence aussi sous le signe de la Nécessité. Dans la plupart des sociétés anciennes, la violence se donnait parfois libre cours, mais sous le signe de la contingence : elle aurait pu ne pas avoir lieu. Dans l’Occident moderne, la violence doit nécessairement avoir lieu. Violence nécessaire de la colonisation (car il fallait apporter la civilisation aux sauvages), terrorisme économique du capital qui, au nom du nécessaire bonheur de tous (c’est-à-dire de la nécessaire croissance des profits), doit jeter des hommes dans la précarité, violences de l’État contre les zadistes, terreur des États-Unis contre l’Irak, d’Israël contre les Palestiniens, de la France contre le Mali. Comme l’a montré Zygmunt Bauman, le judéocide perpétré par les nazis fut un produit nécessaire du capitalisme industriel européen – un accident « normal », dit-il.
Faut-il, pour « sauver » la civilisation, se débarrasser de notions modernistes comme l’instabilité, la complexité, le pragmatisme et même d’une idée bouddhique comme l’impermanence ?
Il est probable que les notions dont vous parlez soient liées à la religion du progrès. On voit bien que l’accélération technologique a des effets destructeurs sur les relations humaines, sur la nature. Tout dépend de ce que l’on entend par instabilité ; si c’est l’instabilité due à l’écoulement du temps, il serait illusoire de chercher à s’en débarrasser. Mais dans notre civilisation, on considère que l’instabilité doit être recherchée. C’est le « bougisme ». Il faut plier l’échine sous le fouet à grande vitesse de la techno-économie. Depuis quelques années, un mot fait florès, « résilience ». Considérant que toute chose doit être soumise à une instabilité généralisée, à des chocs (« de compétitivité » !), les oligarques et leurs idéologues font de la résilience la preuve positive de notre capacité à nous adapter aux chocs qu’ils nous imposent. Beauté de la philanthropie !
Certains, pourtant inquiets de la démiurgie technoscientifique, affirment par ailleurs qu’il ne faut pas brider la recherche scientifique fondamentale, car chercher toujours plus loin serait dans l’essence de l’homme…
Question complexe ! Qu’est-ce qui est dans l’essence de l’homme ? L’infini besoin de connaître, y compris scientifiquement ? Peut-être, mais pas sûr. Je pense pouvoir dire ceci : l’essence de l’homme c’est l’infini de l’imaginaire dans le fini de la réalité sensible. Nous avons besoin d’imaginer à l’infini ? Très bien (c’est peut-être une bonne définition de l’art et de l’homme). Le problème c’est que nous sommes dans une société archi-utilitariste. Dès que la science dite fondamentale trouve quelque chose, « il faut » que la trouvaille soit appliquée, quelles que soient ses conséquences sur nous. En réalité il est devenu très difficile de distinguer entre science fondamentale et science appliquée. Je ne dis pas que la distinction ne puisse pas revenir un jour. Mais aujourd’hui elle n’existe pas. Le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN, Genève) c’est du fondamental ou de l’appliqué ? Le CERN est une technologie sophistiquée de plusieurs milliards d’euros : qui peut croire que c’est de la science pure et fondamentale ? Qui a payé ? Qui finance ? Qui va tirer profit des investissements ?
Un ami marxiste me disait qu’un jour la science résoudrait toutes les questions philosophiques, y compris celles de la métaphysique…
Un certain marxisme se nourrit de la religion technoscientifique occidentale. Il serait plus raisonnable de considérer que nous sommes des êtres sociaux et que la première modalité de notre existence et du déploiement de notre imaginaire social n’est pas le savoir objectif, mais le pouvoir commun. Si celui-ci est menacé par l’objectivisme scientifique, il faut réagir en le bridant.
Ne bride-t-on pas alors l’essence même de l’homme ?
Encore une fois, si l’essence de l’homme c’est l’infini de l’imaginaire dans le fini des corps sensibles, on ne bride pas cette essence quand on limite des recherches qui risquent de porter atteinte aux corps sensibles (d’où vient la bombe d’Hiroshima sinon de la science fondamentale ?). Au contraire, en bridant collectivement, au terme d’un débat démocratique, certaines recherches scientifiques fondamentales, on protégerait l’essence de l’homme. La science moderne, notamment la physique mathématisée, a oublié que le « savoir » a d’abord à voir avec la « saveur », donc avec la sensibilité corporelle. Aujourd’hui les molécules chimiques qu’on trouve dans la nourriture industrielle et dans les cosmétiques cancérisent les corps. On ne peut pas laisser faire.
Comment expliquez-vous que les idées transhumanistes semblent faire leur chemin dans l’opinion publique ? Ceux qui en seraient des victimes s’en réjouissent.
Il me semble qu’il y a deux facteurs convergents qui permettent de comprendre cette diffusion (mais pas de l’expliquer). D’abord, il y a la religion moderne, que j’appelle la scientolâtrie ; elle est un cas particulier de la Signification Imaginaire Générale de l’Occident moderne : la (pseudo)maîtrise (pseudo)rationnelle de la nature (dans la définition de Castoriadis). Cela, c’est le premier facteur. Le second, c’est que, comme dans beaucoup de religions, la scientolâtrie a ses grands prêtres, en l’occurrence les PDG du secteur transhumaniste et les journalistes médiatiques, qui nous « vendent » les idées transhumanistes sans recul critique. Les éventuelles victimes s’en réjouissent parce qu’on leur vend du rêve, la promesse de l’immortalité. Mais votre question met dans le mille : les hommes technolâtres d’Occident sont suicidaires. On le voit bien dans des films de SF comme Minority Report, Bienvenue à Guattaca ou I, Robot. Pour ma part, à l’heure de ma mort, j’espère avoir à mes côtés mes proches plutôt qu’un transhumain plus ou moins robotisé.
Pour affronter l’effondrement à moyen terme,
faudra-t-il plus ou moins d’État ?
Si pendant l’effondrement on veut maintenir l’injustice de l’ordre social tel qu’il est, il faudra plus d’État répressif ; si on veut « profiter » de l’effondrement pour embellir la vie, il faudra moins d’État et plus de communautés autonomes et fédérées. Prenons exemple sur certains peuples premiers, par exemple les Jarawas dans le récent documentaire Nous sommes l’humanité. Je ne dis pas qu’il faut vivre comme eux, je demande simplement : et si nous essayions de retrouver une part de l’insouciance qui est celle des Jarawas ? De surmonter ainsi notre angoisse gadgetomaniaque ?
On entend souvent dire chez les militants que
le pouvoir a peur et donc réagit en se cabrant
dans des mesures sécuritaires. Ne peut-on pas
au contraire imaginer qu’il est conscient d’avoir
la situation sous contrôle, et qu’inversement, la
peur est dans notre camp ?
Difficile de répondre. Je n’ai pas l’impression que dans l’immédiat les oligarques aient peur, car ils tiennent toutes les manettes. Quand ils prennent des mesures liberticides, ils alimentent un cercle vicieux. Quelque part, « la vie est bien faite » : nous, Occidentaux, sommes allés semer le chaos social et moral dans les colonies, et maintenant que le boomerang du chaos nous revient à la figure, cela permet à l’oligarchie de serrer la vis sécuritaire. L’obsession sécuritaire de McWorld et le terrorisme djihadiste sont des ennemis complémentaires : nous devons les rejeter tous les deux.
Contrairement aux marxistes, vous faites un distinguo entre l’économie de marché et le capitalisme…
Plutôt entre le marché et le capitalisme. Polanyi a fait la distinction avant moi. Traditionnellement, le marché était encastré dans la société. Il était limité dans l’espace et dans le temps (un peu comme les marchés actuels où l’on trouve les fruits et les légumes de nos paysans locaux). Mais aujourd’hui, le marché s’est si bien dés-encastré de la société que c’est lui, au contraire, qui encastre et envahit tous les « secteurs » de la société. Le marché devient totalitaire.
Est-il plus souhaitable que l’économie planifiée ?
Non ! Il y a deux extrêmes dans la modernité : l’économie totalement étatisée qu’on a connu en URSS et en Chine communiste, et de l’autre côté, la société totalement marchandisée qu’on a aujourd’hui. Il nous faut retrouver désormais le sens du marché encastré, de l’autonomie productive (agricole et artisanale), et de la coopération avec d’autres unités pour obtenir le complément que nous sommes incapables de produire nous-mêmes.
La lutte des classes a‑t-elle un avenir ?
Tant que la classe dominante fait la guerre à la classe dominée, il faudrait que celle-ci résiste. La « Résistance » est un beau mot, qui doit concerner aussi le présent. Cela dit, la lutte des classes ne peut pas être un idéal politique. Essayons de trouver des solutions politiques pour arriver à une société sans classe, mais pas sur une base industrielle. Tôt ou tard, nous serons amenés – sauf effondrement total – à renouer avec le primat du social, du sacré et de la culture, trois synonymes à mes yeux. Jusqu’à l’avènement du capitalisme, le socio-culturel était premier dans presque toutes les sociétés. Bien sûr que les hommes produisaient des biens « matériels », mais cette activité était encastrée dans des rites socio-culturels. Chez les Achuar (Amazonie), la récolte potagère n’est pas un travail au sens économique, c’est une sorte de rite mythique au cours duquel on cueille les légumes qui sont les enfants de Nunkui, l’esprit des jardins. On ne sortira pas de l’impasse sans se défaire de ce qui nous y a conduits, à savoir la priorité donnée à l’économie, qui détruit la culture sociale. En France, la devise « Liberté-Egalité-Fraternité » devrait présider à tout le reste, car dans le principe elle est sacrée.
Est-ce de l’idéalisme ?
Non, car l’idéalisme chrétien sécularisé c’est la bienveillance dans les mots et la malveillance dans les actes. Il y a quelques semaines, le député européen Philippe Lamberts a joliment « mouché » Macron en lui montrant qu’il clamait en mots les valeurs « Liberté, Egalité, Fraternité », mais que dans ses actes gouvernementaux il bafouait ces trois valeurs. À la religion idéaliste qui sépare les mots et les actes, nous devrions substituer la sacralité politique qui les réunit. Ne confondons pas le religieux et le sacré.
Vous préconisez de parler dorénavant de « dividu » plutôt que d’individu. Pouvez-vous expliquer ?
J’emprunte ce terme à Günther Anders. Nous devrions être des individus, c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas divisées, coupées du social. Malheureusement, la société industrielle nous a divisés-coupés du social et de la nature. Nous sommes donc des dividus, des atomes. Pour sortir de cette atomisation, il nous faudrait retrouver le grand principe du cercle créateur : les individus font la société, et la société fait les individus. Nous sommes des êtres parlants, la langue est la preuve même que c’est la société parlante qui forme l’individu parlant. En retour, celui-ci, en parlant, fait la vie de la langue.
Vous sentez-vous proche de la décroissance ?
Je suis un peu gêné par le terme de décroissance parce qu’il semble refléter la même optique quantitative que la croissance, en se contentant de remplacer le plus par le moins. Par contre, j’approuve les pratiques qui sont derrière le mot : elles sont clairement qualitatives, elles mettent du mieux dans la vie des gens, elles tendent à réenchanter le rapport homme-monde, comme on le voit dans les relations que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes nouent avec le bocage et avec les animaux. Nous ne survivrons pas si nous ne resacralisons pas le monde. Comme le suggère Merleau-Ponty, le monde est notre autre corps, en plus de notre corps personnel, et nos deux corps sont en relation d’entre-tissage.
Propos recueillis en mars 2018 par Bernard
Legros.